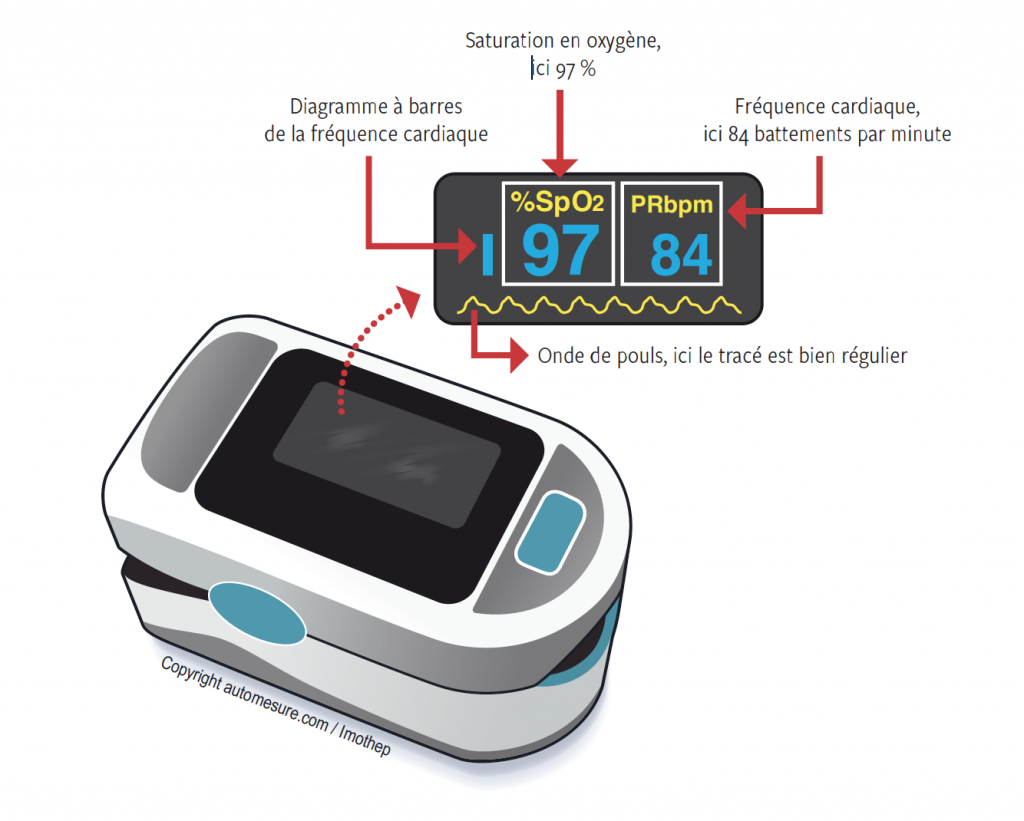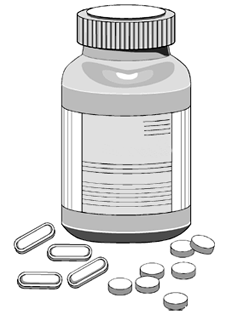Réponses aux questions les plus fréquentes
Qu’est-ce que la tension artérielle ?
Grâce à l’action du cœur, le sang coule dans les artères avec une pression. Quand le cœur se contracte, il chasse le sang dans les artères et la pression monte jusqu’à un niveau maximum dit tension systolique, ou pression artérielle systolique. Quand le cœur se relâche, elle baisse à un niveau minimum dit tension diastolique, ou pression artérielle diastolique. Ainsi, la tension varie continuellement.
Qu’est-ce que l’hypertension ?
On parle d’hypertension lorsque la tension artérielle reste en permanence trop haute. Ce diagnostic est posé par le médecin qui s’assure de la permanence de l’élévation par plusieurs mesures notamment par une automesure. Une authentique hypertension doit être traitée, car sinon elle expose, à plus ou moins long terme, à des accidents cardiaques, vasculaires ou cérébraux. Le traitement de l’hypertension diminue les risques de maladies cardiovasculaires.
Qu’est-ce que l’hypertension blouse blanche ?
Lorsque la tension mesurée par le médecin ou l’infirmière au cabinet médical est plus élevée qu’en automesure au domicile elle demeure au-dessous de 135/85 mmHg en moyenne, on parle alors d’hypertension blouse blanche. L’automesure est particulièrement utile pour reconnaître cette situation assez fréquente.
Qu’est-ce que l’hypertension masquée ?
Lorsque la tension est normale au cabinet médical (c’est-à-dire, au-dessous de 140/90 mmHg) et qu’elle est plus élevée en automesure à domicile (donc avec une moyenne supérieure à 135/85 mmHg) on parle alors d’hypertension masquée. Cette situation peut conduire le médecin à proposer un renforcement du traitement.
Quelles sont les différentes méthodes pour mesurer la tension artérielle ?
La tension se mesure avec un appareil nommé tensiomètre. Les mesures peuvent s’effectuer dans des lieux différents : au cabinet médical (ou de l’infirmière, ou du médecin du travail) ; à domicile ; en pharmacie ou bien en ambulatoire. Ces différentes circonstances ne donnent pas, forcément, des résultats équivalents.
Au cabinet du médecin : Le patient est installé confortablement (en position assise ou couchée). Le médecin doit attendre quelques minutes avant d’effectuer la mesure qui est répétée deux à trois fois de suite. Lors de la première consultation, le médecin mesure la tension aux deux bras.
Chez le pharmacien : Les mesures effectuées dans les pharmacies ne sont pas toujours aussi fiables en raison des moins bonnes conditions de repos et de position.
À domicile : l’automesure. Il est possible de mesurer soi-même sa tension en utilisant un appareil électronique automatique. La mesure se fait au domicile, le matin et le soir.
En déplacement, sur toute une journée ou la nuit : la MAPA. Il est possible d’enregistrer la pression artérielle toute une journée ou même la nuit. L’appareil, qui est prêté par le médecin, se fixe à la ceinture, est équipé d’un brassard enfilé autour du bras qui se gonfle automatiquement (tous les quarts d’heure environ). Une mémoire enregistre les résultats qui seront analysés ultérieurement par le médecin. On parle d’Holter tensionnel ou de mesure ambulatoire de pression artérielle (MAPA). Pendant toute la durée de la mesure ambulatoire, le patient garde ses activités habituelles, peut se rendre à son travail ou faire ses courses ; il dort avec l’appareil.
Pourquoi les chiffres de tension ne sont jamais les mêmes ?
La tension varie en fonction des activités de la vie quotidienne. Elle s’élève transitoirement lors d’un effort, d’une activité physique, d’un sport, d’une émotion, d’un rapport sexuel. À l’inverse, elle baisse pendant le repos et le sommeil. Ces variations naturelles ne sont pas synonymes de maladie : une élévation transitoire de la pression artérielle ne correspond pas forcément à une hypertension artérielle. Le médecin ne parle d’hypertension que si l’élévation est permanente. Seul le médecin fait le diagnostic d’hypertension artérielle.
• En automesure, vaut-il mieux prendre sa tension au bras droit ou au bras gauche ?
L’important est de toujours faire les différentes mesures au même bras. Si vous êtes droitier, mettez le brassard au bras gauche ; faites l’inverse, si vous êtes gaucher. Lors de la première consultation chez votre médecin, la pression artérielle doit être mesurée aux deux bras. En cas de différence importante entre la droite et la gauche, les mesures ultérieures devront être faites au bras où les valeurs les plus hautes ont été retrouvées.
À quelle fréquence faire les mesures ?
Si vous êtes traité pour hypertension, faires une série d’automesure une semaine avant la consultation avec votre médecin afin de lui communiquer des résultats récents. Demandez à lui, si cette fréquence lui convient, car il peut avoir un avis différent. En règle générale, il n’est pas besoin de mesurer sa tension trop souvent. Faire trop de mesures est rarement utile et source de complications pour l’analyse des résultats.
Peut-on mesurer sa tension lors d’un malaise ?
En règle générale, il n’est pas recommandé de mesurer sa tension au milieu de la journée, en cas de maux de tête, stress, douleur ou après un effort. Les mesures faites dans ces conditions sont difficiles à interpréter. Cependant, dans certains cas, il peut être utile de connaître la valeur de la tension au moment d’un malaise, par exemple, pour repérer une trop forte baisse en position debout. Demandez à votre médecin de vous préciser dans quelle circonstance la mesure doit avoir lieu. Par ailleurs, si vous calculez la moyenne de vos résultats, veillez à ne pas « mélanger » les tensions prises matin et soir avec celles mesurées au moment d’un malaise. Elles doivent être bien différenciées.
automesure.com © 2022
Les réponses à ces questions sont conformes aux règles publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), organisme dépendant du ministère de la Santé et celles la Société européenne d’hypertension artérielle.
Rédacteurs : Dr. Nicolas Postel-Vinay et Dr. Guillaume Bobrie pour le site automesure.com